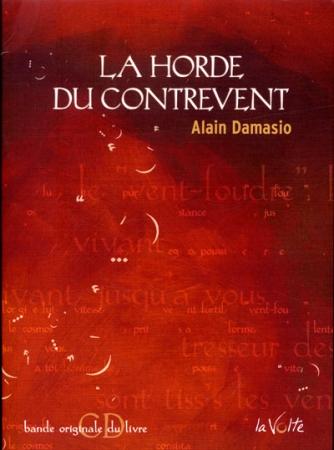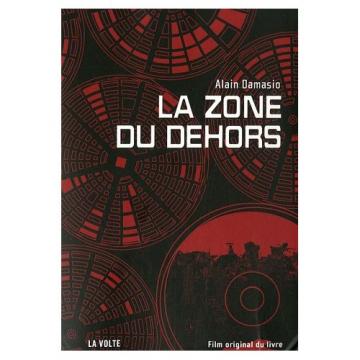« Ceux qui vulgarisent les arcanes disent de la neuvième [forme] qu’elle est la mort-vive. Ça reste une approximation. La neuvième est la mortalité active en chacun, à chaque âge de l’existence. […] En terme aérologique, j’appelle ça l’essoufflement. Les abrités sont avant toute autre critique des essoufflés. »
A. Damasio, La Horde du contrevent.
« Aux premières lueurs de l’amour, le présent et l’avenir sont aux prises pour exprimer l’éternel, et ce ressouvenir est précisément le reflux de l’éternité dans le présent, à condition, bien entendu, que ce ressouvenir soit sain. »
S. Kierkegaard, La Reprise.
Voici la deuxième partie de cet article – qui en comprendra finalement trois – consacré à La Horde du contrevent.
La quête de la horde – trouver l’origine du vent – est-elle absurde ? Dans sa finalité littérale, cela ne fait pas de doute. Dès les premières pages, Sov la qualifie de « rêve têtu, de la plus haute crétinerie » (p. 481) ! « Il n’y a pas d’Extrême-Amont », nous est-il même dit en toutes lettres, d’abord par la bouche provocatrice de Caracole (p. 460) puis dans un « livre » de la Tour d’Ær (p. 192). Il n’y a pas d’Extrême-Amont en effet, du moins tel que les hordiers le conçoivent… Certains imaginent un jardin d’Éden, d’autres s’attendent à une explosion titanesque (un Big Bang ?), d’autres encore à une finis terrae dont on prétend qu’elle pourrait être la proue d’un gigantesque navire… Chacun investit l’Extrême-Amont de ses propres désirs. Mais si celui-ci existe bien – sous une forme ou une autre –, l’Origine nouménale, la Vérité originelle, est quant à elle inatteignable, comme de nombreux indices nous le suggèrent. Ainsi la horde possède-t-elle son Oméga (le glyphe de Golgoth, qui est aussi le symbole de l’ohm, unité de résistance électrique, ou encore, qui représente l’univers des possibles) mais pas son Alpha… Caracole, lui, a pour glyphe, en plus de l’apostrophe venteuse, un point d’interrogation renversé, qui en espagnol ouvre une question – ici sans être refermée... Ou encore : Melicerte, nom de famille d’Oroshi, est une pièce inachevée de Molière… L’important n’est pas tant d’atteindre le but, que de chercher à l’atteindre. Alain Damasio semble considérer que le sens de cette quête est totalement immanent, né de l’effort physique, de l’affrontement, du courage, du lien dense qui unit les hordiers. Pourtant, chercher l’Extrême-Amont, c’est déjà chercher un sens à sa propre vie, chercher l’Origine et aller de l’avant, autrement dit, s’étendre vers son propre aval et son propre amont… L’Extrême-Amont est un grand Dehors, un « idéal régulateur », c’est-à-dire une idée qui, selon Kant, n’est jamais constitutive, mais seulement régulatrice : règle de l’esprit plutôt qu’objet objectif. Le but, c’est le chemin. Le but, c’est, littéralement et métaphoriquement, la trace. Pure volonté de puissance !
Freud évoque dans Totem et Tabou le mythe de la « horde primitive » (ou « horde originaire »), un groupement humain préhistorique soumis à la domination sans limite d'un mâle tout-puissant, fort et brutal, ayant fonction de père – « le Surhomme que Nietzsche n’attendait que dans l’avenir », écrivait Freud au dixième chapitre de Psychologie collective et analyse du moi. Or ce mâle dominant aurait littéralement été tué et mangé – absorbé, comme un vif… – par ses fils coalisés. « Le père originaire avait certainement été le modèle envié et redouté de chacun des membres de la troupe des frères », écrit Freud. « Dès lors, dans l’acte de le manger, ils parvenaient à réaliser l’identification avec lui, s’appropriaient chacun une partie de sa force. »[1] Ce meurtre du père symbolique (aimé autant qu’haï) et sa totémisation auraient rompu avec l’état immuable de la horde originaire darwinienne (qui, comme le précise Freud, ne réserve « aucune place aux débuts du totémisme »), et seraient à l’origine de la civilisation et de ses deux grands tabou, l’inceste et le cannibalisme. En effet, « Au commencement était l’acte »[2], conclut Totem et Tabou, citant le premier acte du Faust de Goethe… Dans un article publié en 1924, « La Foule et la horde primitive », Freud écrit aussi avoir essayé « de montrer que les destinées de cette horde ont laissé des traces ineffaçables dans l'histoire héréditaire de l'humanité »… Chaque meneur de foule est un père originaire. La horde de Damasio, avec son Golgoth dans le rôle du Surhomme dominant et garant de l’(h)ordre, trace (écrit) une ligne de fuite sur les pas de la précédente horde, elle forme le tracé d’un devenir. Et ce devenir, nous allons le voir, est aussi un éternel retour. Elle pose des jalons moins destinés à être suivis qu’à être repris par la horde reconstituée...
*
Le temps de La Horde est assurément cyclique (voir le ruban de Möbius, symbole de l’infini, glyphe des frères Dubka), ou plutôt spiralé à la manière d’une vis. La spirale est un motif récurrent du livre. L’incroyable force du néphèsh de Te et Ne Jerkka, souffle tranchant tiré du vif, fait se tordre leur traits, enspiralés autour d’un point central. On ne compte plus, évidemment, les tourbillons et autres vortex (et même, des « vortextes ») dont ce roman venteux est parsemé. Sans oublier la belle Coriolis, au nom plus qu’évocateur, et Caracole ! En architecture, un escalier en caracole est, tout simplement, un escalier en colimaçon. Le retour final de Sov à Aberlaas, en Extrême-Aval, après sa longue chute d’Extrême-Amont, laisse à penser que la Terre elle-même est non seulement plus ou moins sphérique (ouf !), mais, en outre, légèrement spiralée en son centre, comme une coquille d’escargot… À moins qu’elle soit un anneau de Möbius ! Dans la Tour d’Ær, deux livres-lingots portent le titre « Vivre ». Le premier dit : « Vis chaque instant comme si c’était le dernier. », et le second : « Vis chaque instant comme si c’était le premier. » (p. 196) La vie, non comme une boucle, mais comme une reprise… Comme une vis. Rotation/translation.
« Si le vent a recommencé à forcir, son influence paraît nulle sur l’allure du chrone qui s’approche de nous à la vitesse d’un pas humain, guère plus. Il est à moins d’une centaine de mètres maintenant. Une angoisse s’instaure, elle monte à le regarder silencieusement glisser dans notre direction, avec sa forme de bulbe, de cocon oblong aux parois flottantes qui étanchent la lumière… Alentour du chrone, le vent comme se tait, le son se dissout et s’éteint. C’est une forme de silence épais qui dérive, une présence sans visage ni morphe appropriable, mais dont on pressent physiquement la puissance. […] De près, la surface n’a rien de très organique, elle ressemble plutôt à cette nappe de métal liquide, fluente, que Léarch obtient parfois à haute température dans son creuset. […] Il doit faire dans les cinq mètres de haut sur cinq de large et une trentaine de long. Et pour qui scrute attentivement, pour qui sait où porter le regard, il est couvert de glyphes, à moitié fondus dans le gris plomb des parois, des glyphes mouvants, comme tracés à l’instant, que je n’arrive décidément à rattacher à aucune écriture connue. Des bouts de courbe, des segments de traits, virevoltants et conjoints, suffisamment pour évoquer une volonté, à moins… À moins que j’y injecte, en humain, un sens qui n’y est pas, un dessin qui ne soit qu’un hasard de mouchetures et d’incisions… » (p. 490)
Le cas des chrones (Sov nous donne la description de l’un d’entre eux dans l’extrait ci-dessus) est assez complexe, difficilement appréhendable, sans doute parce qu’ils constitueront l’un des éléments majeurs du deuxième tome prévu à l’époque par l’auteur. Ces phénomènes temporels – des « concepts vivants » dixit Damasio –, faits de vent et de glyphes, comme si le roman lui-même flottait littéralement dans les airs, donnent parfois des aperçus du passé ou de l’avenir – du récit à venir. C’est que, de notre point de vue, les chrones sont une fixation dans la diégèse d’un état intermédiaire du processus « métamorphotique » évoqué plus haut. Irruption, dans le monde du roman, de signes d’un autre monde, le nôtre – celui de l’auteur. Ce que métaphorisent les chrones, c’est, en quelque sorte, la métaphorisation elle-même – la métamorphose, comme en témoigne l’extrait cité plus bas. D’où, en partie, leur temporalité spécifique.
Caracole, un autochrone (une forme particulière, bergsonienne, de chrone qui s’autodifférencie), assène ses prophéties à ses compagnons hordiers. « Tu ne mourras pas ! » affirme-t-il à Sov, au début du roman. Pourquoi ? « Parce que tu es le héros du carnet ! » (p. 470) Après l’épreuve du Vortex, qui a montré à ceux qui en ont contemplé le puits sans fond des images de leur avenir, Caracole nuance :
« Cette scène que nous vivons par exemple, elle existait déjà. Tout a déjà existé et tout existera un jour à nouveau. Tout reviendra intact, tel quel. Le chrone ne prévoit rien, il fait juste défiler à toute allure les boucles de temps qui le constituent, il n’est que le trajet d’une mémoire circulaire, dense à hurler. Ce qui circule en lui n’est en fait que du passé. D’un certain point de vue. Sauf que ce passé est pour nous un avenir puisque nous rampons vers lui, risibles escargots, dans un segment minuscule du circuit. Notre esprit a capté les scènes que nous cherchions, il a trié à la volée dans le défilement. Sans que je sache comment qu’il a fait, notez bien, ni pourquoi donc et quand bien même que ! » » (p. 285)
Ainsi, en dépit des apparences, tout ne serait pas écrit :
« Non, tout s’écrit. Et tout s’écrit en ce moment même, dans mes veines, avec mes forces intimes, par leurs combats. Le chrone nous a montré ce que nous deviendrons si nous continuons à être ce que nous sommes. Steppe deviendra un arbre s’il continue à favoriser le végétal en lui. » (p. 284)
Argument qui ne vaut que si le temps n’est pas linéaire… En tout état de cause, c’est bien le destin qui est montré par les chrones. Un futur déjà advenu dans le passé… Et le destin de la horde, apprenons-nous, est de renaître par le vif, agrégée autour de Sov. La pagination à rebours, déjà rencontrée ailleurs (par exemple dans Survivant de Chuck Palahniuk) ne représente pas seulement le temps et l’espace qui séparent la horde de l’Extrême-Amont : elle est aussi retour en arrière, vers cette Origine, qui ne saurait être que renaissance. Un compte à rebours (ici, jusqu’à la page zéro) aboutit généralement à une explosion (cf. plus haut, le récit cosmogonique de Caracole), ou à un départ, comme le suggèrent les tout derniers mots du roman, chute qui fait suite à une autre, tout aussi vertigineuse : « Tu viens de naître ou quoi ? » (p. 0)…
Tout commencement, du reste, est déjà un retour, mais pas un retour au même… La Horde du contrevent est un récit de l’éternel retour nietzschéen interprété par Gilles Deleuze. Pour ce dernier, l’éternel retour, force centrifuge, est sélectif, il est la constante activation du vouloir, comme il l’écrit dans son Nietzsche : « Le Même ne revient pas, c’est le revenir seulement qui est le Même de ce qui devient. […] ». Car « quoi que je veuille […], je “dois” le vouloir de telle manière que j’en veuille aussi l’éternel Retour. » La définition qu’en donne Alain Damasio dans l’entretien accordé à Galaxies (des hordiers, « ne reviendra que le plus vivant ») pourrait être longuement discutée : du plus vivant au plus fort, il n’y a qu’un pas... (Dans les romans damasiens, seul celui qui sait à chaque instant se réinventer, se construire librement, non seulement survit, mais mérite de survivre. L’énonciateur – l’auteur ? – n’a que peu d’égards pour les faibles, les mous, ceux qui prennent racine. Mais, pour des raisons qui vous apparaîtront plus loin, et contrairement à mon intention initiale, je ne m’étendrai pas sur ce problème, qui dans La Horde n’en est pas vraiment un…) On reconnaît également là le concept kierkegaardien de « reprise », qui est « ressouvenir en avant », entre souvenir et espérance. Reprise de soi, en somme. Voilà donc révélé le sens du « futur déjà advenu » évoqué plus haut avec les flashes du Vortex. Comme l’amoureux passionné du texte de Kierkegaard, les hordiers se ressouviennent d’événements pas encore advenus, qui dès lors les en libèrent.
Quand Caracole, dans la Tour d’Ær, évoque les Trois Métamorphoses d’Ainsi parlait Zarathoustra (cf. extrait ci-dessous), il prédit le destin de Sov, qui de chameau (hordier obéissant), devient lion à la fin du roman (hordier révolté), mais qui pour faire renaître la horde, devra devenir enfant, c’est-à-dire celui « qui crée sa voix, et qui la fera entendre » (p. 187).
« Qu’est-ce qui est lourd ? demande l’esprit qui respecte et qui obéit, que je puisse, en héros, en bon hordier, porter les plus lourdes charges. Ainsi parle le chameau. Je te fais la version courte, note bien ! Et solidement harnaché, il marche vers son désert et là il devient lion. Devant lui se dresse le dragon des normes millénaires et sur chacune de ses écailles brillent en lettres d’or ces valeurs et ces mots : “Tu dois.” Mais le lion dit “Je veux !” – sauf qu’il ne sait pas encore ce qu’il peut bien vouloir, il n’a fait que se chercher un dernier maître pour le contredire, que se rendre libre pour un devenir qu’il est encore incapable d’incarner. Alors survient la troisième métamorphose : le lion devient enfant. Innocence et oubli, premier mobile, roue qui roule d’elle-même, recommencement et jeu, et l’enfant dit “Je crée.” Ou plutôt, il ne dit plus rien : il joue, il crée. Il a trouvé son Oui, il a gagné son monde. » (p. 188)
Nous retrouvons là, intacte, la nécessité vitale de se réinventer sans cesse, de danser au bord de l’abîme, homme souverain, dans un monde où, sous le joug des forces nihilistes, tout tend à revenir. Le glyphe de Sov est une parenthèse, que rien ne nous empêche de considérer comme un fin croissant de lune, symbole pour les Musulmans de résurrection… La vie des hordiers est une ritournelle, image vivante et éminemment collective de la « différance » derridienne (les hordiers n’existent qu’en tant qu’ils se distinguent des autres, en tant qu’ils sont la constante mise en acte de cette distinction) où pulse la puissance vitale des vifs. La ritournelle, c’est ce qui permet à l’enfant de surmonter sa peur du noir – ou de la neuvième forme. De reprendre du terrain sur les ténèbres, en s’accordant à nouveau au territoire connu.
« Un autochrone n’a que des différences de potentiels en lui. Que des vitesses, c’est un corps fait de vitesses. […] Ça veut dire qu’il n’est rien : il agit. Il n’a pas d’identité. Il ne vit que de différences. Il est la différence de toutes les identités, l’écart en cours. Il a besoin de matière, toujours, tout le temps, pour mettre en acte ces différences. » (p. 330)
*
Qu’est-ce que vivre ? Comment rester vivant ? Telle est la question fondamentale posée par Alain Damasio, à laquelle ses livres tentent de répondre. Dans La Zone du Dehors, la vie, c’était le mouvement, tendu vers un ailleurs. Ça l’est toujours, notamment avec Caracole l’autochrone et la quête de l’Extrême-Amont :
« N’acceptez pas que l’on fixe, ni qui vous êtes, ni où rester. Ma couche est à l’air libre. Je choisis mon vin, mes lèvres sont ma vigne. Soyons complice du crime de vivre et fuyez ! Sans rien fuir, avec vos armes de jet et la main large, prête à s’unir, sobre à punir. Mêlez-vous à qui ne vous regarde, car lointaine est parfois la couleur qui fera votre blason. […] Le cosmos est mon campement. » (p. 458)
Les valeurs de la horde (l’effort physique soutenu, l’endurance, la persévérance, leur mission commune…) vainquent la monotonie, qui n’est, selon Caracole, « qu’un symptôme de la fatigue » (p. 404).
« À chaque dimension de la vitesse correspond une lenteur ou une fixité propre. À la rapidité s’oppose la pesanteur ; au mouvement s’oppose la répétition ; au vif s’oppose le continu. D’une certaine façon, être vivant ne s’atteint que par ce triple combat : contre les forces de gravité en nous – la paresse, la fatigue, la quête du repos ; contre l’instinct de répétition – le déjà-fait, le connu, le sécurisant ; et enfin contre les séductions du continu – tous les développements durables, le réformisme ou ce goût très fréole de la variation plaisante, du pianotement des écarts autour d’une mélodie amusante. » (p. 393)
[1] S. FREUD, Totem et Tabou. Quelques concordances entre la vie psychique des sauvages et celle des névrosés, trad. de l’Allemand par Marielène Weber, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1993, p. 290.
[2] Op. cit., p. 318.